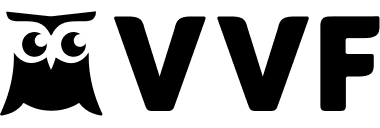La négociation annuelle obligatoire (NAO) est un rendez-vous incontournable du dialogue social en entreprise. Instaurée il y a plus de 40 ans, cette négociation entre employeur et représentants des salariés a pour objectif d'aborder des thèmes comme la rémunération, l’égalité professionnelle ou encore les conditions de travail.
Inscrites dans la loi, les NAO sont pourtant souvent mal comprises et intégrées en entreprise.
Comment vous préparer efficacement à vos prochaines NAO et les adapter à vos grands enjeux ? On vous éclaire.
Qu’est-ce que la NAO en entreprise ?
Définition et objectifs de la négociation annuelle obligatoire
Créée par les lois Auroux en 1982, la négociation annuelle obligatoire (NAO) est une négociation collective entre représentants des salariés et employeurs.
Survenant chaque année, elle vise à renforcer le dialogue social en instaurant un temps d’échange régulier sur des sujets comme la rémunération, l’emploi, l’égalité femmes-hommes et les conditions de travail, entre autres.
L'objectif de la NAO est de parvenir à des accords améliorant la situation des salariés tout en maintenant la performance de l’entreprise.
En pratique, cette négociation permet de prévenir les conflits en traitant en amont les revendications salariales ou liées aux conditions de travail.
A noter : l’obligation porte sur le fait de négocier de bonne foi, pas d’aboutir nécessairement à un accord. Autrement dit, l’employeur doit ouvrir la discussion sur les thèmes prévus, mais n’est pas contraint légalement de signer un accord à l’issue des échanges.
Les acteurs concernés : employeur, CSE, syndicats
La NAO implique principalement deux parties : la direction de l’entreprise (l’employeur ou ses représentants) et les délégués syndicaux représentant les salariés. En effet, seules les organisations syndicales représentatives peuvent négocier et conclure des accords collectifs au nom des salariés. Ainsi, la NAO est obligatoire uniquement dans les entreprises où au moins un syndicat représentatif est présent.
Lorsqu’une NAO a lieu, l’employeur prend l’initiative de convoquer les partenaires sociaux à la table des négociations. Ainsi doivent être présents lors d’une NAO un délégué par syndicat représentatif (chacun pouvant être accompagné d’un salarié) et l’employeur lui-même ou un membre de la direction pour le représenter.
Le comité social et économique (CSE) en tant que tel n’est pas directement partie prenante de la NAO, sauf si ses membres sont aussi délégués syndicaux.
Les obligations légales liées à la NAO
Le cadre du Code du travail
La NAO est encadrée par le Code du travail, aux articles L.2242-1 et suivants. Elle fait partie des négociations collectives dites "obligatoires" dans l’entreprise. Le Code du travail précise que l’employeur doit engager périodiquement des négociations sur les domaines fixés (voir paragraphe plus bas).
Comme mentionné précédemment, l’obligation est une obligation de moyen : l’employeur doit convoquer et négocier loyalement, mais n’a pas l’obligation d’aboutir à un accord. En cas d'échec, il devra simplement établir un procès-verbal de désaccord.
A noter : En 2025, 21 % des entreprises ont enregistré des procès-verbaux de désaccord, un chiffre en augmentation par rapport à 2024, avec 18 % des entreprises dans ce cas.
Depuis la réforme Rebsamen de 2015, la loi a regroupé les douze anciens sujets de négociation en trois grands volets thématiques obligatoires.
Par ailleurs, les ordonnances de 2017 (dites ordonnances Macron) ont assoupli la périodicité des NAO : il est possible, par accord d’entreprise, de prévoir que les négociations n’auront lieu que tous les 2, 3 ou 4 ans au lieu d’être annuelles.
Les entreprises concernées et la fréquence des négociations
La règle générale est la suivante : toute entreprise où est présent au moins un délégué syndical est tenue d’engager des négociations obligatoires. En pratique, cela correspond aux entreprises de 50 salariés et plus ayant une ou plusieurs sections syndicales représentatives.
Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, l’obligation peut s’appliquer uniquement si un représentant du personnel au CSE a été désigné comme délégué syndical (ce qui suppose la présence d’un syndicat). S’il n’existe pas de syndicat dans l’entreprise, l’employeur n’a aucune obligation de NAO avec le CSE.
Concernant la périodicité, le Code du travail prévoit qu’il faut négocier périodiquement sur les thèmes obligatoires. Par défaut (en l’absence d’accord de méthode contraire), ces négociations ont lieu chaque année, d’où le terme "négociation annuelle" obligatoire. Toutefois, un accord collectif d’entreprise peut fixer une fréquence différente pour tout ou partie des thèmes, avec un maximum de 4 ans entre deux négociations sur un même sujet. En d’autres termes, la NAO n’a plus à être strictement annuelle si les partenaires sociaux conviennent de la regrouper tous les deux ans, par exemple.
En pratique, beaucoup d’entreprises continuent d’organiser des NAO tous les ans, souvent en fin d’année ou au début de l’année suivante, afin de traiter régulièrement les demandes (notamment salariales). D’autres peuvent opter pour une négociation biennale englobant plusieurs thèmes à la fois, surtout si un accord de méthode a été conclu en ce sens. L’important est de respecter au minimum la périodicité légale : au moins tous les 4 ans sur les volets rémunération et égalité/QVCT, et tous les 3 ans sur le volet emploi.
Les sanctions en cas de non-respect
Ne pas respecter les obligations de NAO expose l’employeur à des sanctions potentiellement lourdes. Le Code du travail considère le refus d’engager une négociation obligatoire comme un délit d’entrave au dialogue social. Concrètement, un employeur qui ne convoque pas de NAO alors qu’il y est tenu risque jusqu’à un an de prison et 3 750 € d’amende.
En outre, des pénalités financières spécifiques peuvent s’appliquer sur certains thèmes. Par exemple, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’absence de négociation sur l’égalité professionnelle (ou l’absence d’accord et de plan d’action unilatéral sur ce sujet) peut entraîner une pénalité correspondant à 1% de la masse salariale annuelle. Ce "malus" est prononcé par l’inspection du travail et versé à un fonds public si l’employeur n’a ni accord égalité femmes-hommes ni plan d’action en place. De même, le fait de ne pas respecter l’obligation de négocier sur les salaires effectifs peut conduire la DREETS (anciennement Direccte) à appliquer une pénalité financière à l’entreprise.
En résumé, ne pas organiser de NAO est illégal et expose le dirigeant à des sanctions pénales. Ne pas aborder l’un des thèmes obligatoires (salaires, égalité…) peut également coûter cher à l’entreprise (pénalités administratives). Au-delà du risque juridique, faire l’impasse sur la NAO envoie un mauvais signal aux salariés et peut dégrader le climat social.
Les 3 parties de négociation obligatoire
Suite à la loi Rebsamen de 2015, les thèmes auparavant nombreux de la NAO ont été regroupés en trois grands volets thématiques, qui couvrent l’ensemble des sujets que l’employeur doit proposer à la négociation.
1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur
Le premier volet concerne la rémunération au sens large. Il inclut plusieurs sous-thèmes obligatoirement abordés :
- Les salaires effectifs : niveaux de salaires, augmentations générales et individuelles, minima conventionnels, etc.
- La durée du travail et son organisation : aménagement du temps de travail, heures supplémentaires, astreintes, travail de nuit, temps partiel, jours de repos, etc.
- Le partage de la valeur ajoutée : c’est-à-dire la mise en place ou la révision des dispositifs d’intéressement, de participation aux bénéfices et d’épargne salariale, ainsi que d’éventuelles primes exceptionnelles de partage de la valeur.
Pour ce volet de la NAO, les discussions portent souvent sur le pouvoir d’achat des salariés. Les syndicats arrivent avec des revendications (revalorisation des salaires de base et attribution de primes fixes), tandis que l’employeur expose sa situation économique et la marge budgétaire dont il dispose.
Des sujets comme la réduction/réorganisation du temps de travail (horaires, RTT, éventuelle semaine de 4 jours) peuvent être abordés si pertinents.
En résumé, ce premier bloc vise à ajuster la rémunération et les avantages financiers des salariés, thèmes souvent prioritaires.
2. Égalité professionnelle et qualité de vie au travail
Le deuxième volet porte sur les mesures visant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, plus généralement, la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) au sein de l’entreprise.
Sur la partie égalité femmes-hommes, la NAO doit aborder les moyens de supprimer les écarts de rémunération et de carrière entre les sexes, l’accès des femmes aux promotions ainsi qu’aux formations. Cela inclut aussi la lutte contre le sexisme au travail et les discriminations liées par exemple au handicap, à l’âge, à l’origine ou à l’orientation sexuelle.
Au-delà de l’égalité stricte, ce volet intègre la thématique plus large de la qualité de vie au travail. Il s’agit de discuter des actions pour améliorer le bien-être des salariés : équilibre vie professionnelle/vie personnelle, conditions de travail (aménagement des postes, prévention de la pénibilité et des risques psychosociaux), droits sociaux (droit à la déconnexion, horaires flexibles, télétravail, services aux salariés comme la crèche d’entreprise, etc.).
L’idée est de traiter tout ce qui contribue à créer un environnement de travail sain, inclusif et motivant. Par exemple, lors de la NAO, les parties peuvent négocier des mesures pour faciliter la parentalité (congés, horaires adaptés), l’inclusion des personnes en situation de handicap, la formation professionnelle pour tous, ou encore des dispositifs de bien-être (soutien psychologique, activités sportives...).
Ce deuxième bloc a pour but d’assurer l’équité et le bien-être dans l’entreprise. La loi incite fortement à conclure un accord sur l’égalité professionnelle ; à défaut, l’employeur doit établir chaque année un plan d’action unilatéral pour progresser sur ce sujet. Les discussions sur la QVCT, quant à elles, reflètent une attente grandissante des salariés de travailler dans de bonnes conditions. En abordant ces thèmes, l’entreprise peut améliorer la santé de ses collaborateurs et sa marque employeur sur le long terme.
3. Gestion des parcours professionnels et emploi
Le troisième volet est aussi appelé GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) ou GEPP. Ce thème n’est obligatoire que dans les entreprises de 300 salariés et plus. Pour les plus petites, il n’est pas imposé par la loi (mais rien n’empêche d’en parler volontairement). Lorsqu’il s’applique, ce bloc doit être négocié au moins une fois tous les 3 ans (et peut l’être lors d’une NAO annuelle ou via un accord spécifique).
La négociation sur la gestion des parcours professionnels porte sur la façon dont l’entreprise anticipe et accompagne l’évolution de ses emplois et compétences. Il s’agit par exemple de discuter des perspectives de carrière offertes aux salariés, de la formation professionnelle, de la mobilité interne, de la gestion des âges (jeunes talents, seniors), ou encore de la politique de recrutement et de sécurisation des emplois.
Concrètement, une NAO sur ce thème peut aboutir à un accord GPEC prévoyant des mesures telles que : plans de formation pluriannuels, dispositifs de reconversion interne, identification des métiers stratégiques et des compétences à acquérir, aide à la mobilité géographique ou fonctionnelle, etc.
Elle peut aussi traiter de la gestion des fins de carrière (dispositif de départs anticipés, retraite progressive) ou de l’égalité des chances dans l’évolution professionnelle.
NAO 2025 : les sujets à aborder
Les demandes prioritaires des salariés et syndicats
Dans le contexte actuel, les revendications prioritaires des salariés et de leurs représentants tournent principalement autour de la rémunération. La forte inflation des dernières années a érodé le pouvoir d’achat, si bien que des hausses de salaires substantielles sont attendues lors des NAO.
Les syndicats mettent généralement en avant des demandes d’augmentations générales et individuelles pour récompenser l’ancienneté ou la performance. La question des primes revient aussi fréquemment (13ᵉ mois, prime de partage de la valeur, prime de transport, etc.), tout comme la revalorisation des avantages sociaux existants pour soulager les dépenses quotidiennes des salariés.
Il ressort que le sujet du pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations. Par exemple, face à l’envolée des prix, de nombreux salariés estiment qu’une augmentation significative est nécessaire pour maintenir leur niveau de vie : en 2024, près de 48% des salariés français considéraient qu’une hausse de salaire de 6 à 10% serait nécessaire pour les dissuader de changer d’employeur. Ce chiffre illustre l’ampleur des attentes en matière de rémunération et de reconnaissance financière. Les syndicats, sensibles à ce risque de turnover, font donc du bien être financier une priorité pour les NAO 2025.
Outre les salaires, les représentants du personnel peuvent avoir d’autres revendications importantes. Par exemple, l’égalité professionnelle femmes-hommes demeure un sujet de vigilance, de même que l’amélioration des conditions de travail. La baisse du temps de travail (passage éventuel à 4 jours, augmentation des jours de RTT) peut être portée par certains syndicats comme alternative aux hausses salariales.
Enfin, avec la transformation du travail post-Covid, le télétravail et la QVCT figurent souvent dans le discours syndical.
L’impact de l’inflation et du pouvoir d’achat
La présence de la rémunération comme sujet clé des NAO 2025 s’explique directement par un contexte défavorable au pouvoir d’achat des salariés Français. Après des pics à 5% d’inflation en 2022 et 2023, la hausse des prix commence à ralentir. Néanmoins, ces deux années de forte inflation ont fortement rogné le pouvoir d’achat des salariés.
Beaucoup ont vu leurs dépenses (énergie, carburant, alimentation…) augmenter plus vite que leurs salaires, et prendre donc plus de place dans leur budget qu’auparavant. En 2025, les collaborateurs s’attendent donc toujours à des gestes compensatoires de la part de leur employeur.
Du côté des entreprises, le contexte économique n’est pas simple non plus. La même inflation ne les a pas aidées, tandis que les perspectives économiques sont toujours incertaines. Les marges des entreprises sont souvent sous contrainte, ce qui limite leur capacité à accorder des augmentations générales. De plus, certaines entreprises sortent de plusieurs années d’aides et de prêts (post-crise COVID) et cherchent à restaurer leur santé financière. Ainsi, la NAO 2025 s’inscrit dans un contexte paradoxal : d’un côté, des salariés frappés par la vie chère et plus exigeants en termes de rémunération ; de l’autre, des employeurs faisant face à des équilibres budgétaires fragiles.
Concrètement, on constate déjà que les accords signés fin 2024 (NAO pour 2025) reflètent cette tension. Selon Groupe Alpha, la moyenne des augmentations salariales négociées lors des NAO de l’automne 2024 s’est établie autour de 2,3%, en baisse notable par rapport à l’année précédente (3,5% en 2024). Parallèlement, la proportion d’entreprises ne prévoyant aucune hausse salariale a augmenté : 33% des entreprises n’ont pas budgété d’augmentation de salaire pour 2025, contre 23% l’année précédente.
Face à ce dilemme, des solutions alternatives émergent souvent dans les négociations pour soutenir le pouvoir d’achat. Par exemple, beaucoup d’employeurs proposent le versement de primes ponctuelles défiscalisées (la Prime de Partage de la Valeur notamment) plutôt que des augmentations de salaire pérennes.
De même, les avantages sociaux sont plus que jamais considérés dans les NAO afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés.
Les nouvelles attentes liées à la QVCT et au télétravail
Au-delà du salaire, la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) est devenue un enjeu central. En 2024, un baromètre a montré que 90% des salariés français considèrent la QVCT comme une priorité. Autrement dit, presque tous les employés accordent de l’importance à des facteurs comme l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, la flexibilité dans l’organisation du travail, un climat respectueux, ou encore le sens et les valeurs au travail. Ces préoccupations, renforcées par la pandémie et les nouvelles générations arrivant sur le marché du travail, se reflètent désormais dans les NAO.
Le télétravail est l’une des évolutions majeures des dernières années à prendre en compte pour les NAO 2025. Pratique marginale il y a encore une décennie, il s’est démocratisé : en 2023, environ 33% des salariés français télétravaillaient au moins une fois par semaine (contre seulement 25% en 2017).
Le droit à la déconnexion fait aussi partie des attentes fortes lors de ces négociations. En 2025, c’est donc l’occasion pour beaucoup d’entreprises de formaliser ou d’ajuster l’accord de télétravail : nombre de jours autorisés, volontariat, et même prise en charge du matériel et des coûts (internet, électricité).
Plus globalement, les salariés expriment une recherche d’un meilleur équilibre vie pro/vie perso. Par exemple, la possibilité d’aménager son temps de travail (arrivées et départs flexibles, demi-journées pour enfants malades, etc.) ou de bénéficier de congés additionnels peut être mise sur la table.
Les aspirations des collaborateurs portent également sur la santé mentale et le sens du travail : ils attendent de leur employeur qu’il prenne en compte la charge de travail, qu’il reconnaisse les efforts fournis et qu’il partage une vision porteuse de sens. Autant de sujets qui, sans faire l’objet d’indicateurs chiffrés comme les salaires, peuvent être discutés lors des NAO.
Comment bien préparer et réussir une NAO ?
Les étapes clés de la préparation
Pour que la NAO soit une réussite, la préparation en amont est fondamentale. Voici les étapes clés à suivre pour les équipes RH et dirigeantes :
- Anticiper le calendrier et les besoins : la NAO se prépare plusieurs mois à l’avance. Fixez une date prévisionnelle pour la négociation (par exemple en fin d’année civile, c’est souvent à ce moment que se discutent les augmentations pour l’année suivante) et réservez des créneaux de réunion. Identifiez les thèmes obligatoires à aborder selon votre contexte. Enfin, prenez connaissance des éventuelles nouveautés légales ou conventionnelles qui pourraient influencer la NAO (par exemple une nouvelle grille de minima sociaux, une loi récemment votée sur le partage de la valeur, etc.).
- Recueillir et analyser les données clés : Rassemblez toutes les informations factuelles nécessaires pour étayer les discussions. Cela inclut les données internes : situation économique et financière de l’entreprise (chiffre d’affaires, marge, résultats), masse salariale et structure des salaires, bilans sociaux (rapports égalité femmes-hommes, index égalité, rapports sur la pénibilité, etc.), chiffres de turnover et d’absentéisme si vous en avez, résultats d’éventuelles enquêtes internes d’engagement... Compilez aussi des données externes utiles : évolutions de salaires dans votre branche ou chez vos concurrents, références de convention collective. Cette base chiffrée donnera de la crédibilité à vos arguments et permettra d’objectiver le dialogue avec les syndicats.
- Consulter les managers et les salariés : Prenez le pouls des attentes du personnel avant d’entrer en négociation. Les managers de proximité peuvent remonter les principales préoccupations de leurs équipes. Vous pouvez aussi mener un bref sondage interne ou analyser les questions fréquemment posées au CSE pour cerner les sujets de mécontentement. L’objectif est d’identifier les revendications probables des syndicats et de prévoir des éléments de réponse sur les points sensibles. Impliquer les managers dans la préparation aide également à les aligner sur le discours de l’entreprise pendant la NAO.
- Respecter le formalisme légal : La NAO est un processus encadré par le Code du travail, avec des règles précises de déroulement. Assurez-vous de bien les respecter. D’abord, invitez formellement les organisations syndicales à négocier, par lettre ou email de convocation, en précisant la liste des thèmes à aborder. Cette convocation doit être envoyée suffisamment tôt pour permettre aux syndicats de se préparer. Ensuite, organisez la réunion préparatoire obligatoire prévue par l’article L2242-14 : lors de cette première rencontre, on fixe avec les délégués syndicaux le calendrier et le nombre de réunions, et on précise les informations que l’employeur fournira (ex : documents économiques, rapports obligatoires) ainsi que leur date de remise. Enfin, transmettez en amont tous les documents requis : la loi oblige l’employeur à communiquer aux négociateurs syndicaux un certain nombre d’indicateurs (bilan social, comparatif des rémunérations H/F, etc.) avant la NAO.
- Établir une stratégie de négociation : Préparez votre position sur chaque sujet avant d’entamer les discussions. Il s’agit de définir ce que vous pouvez proposer et jusqu’où vous pouvez aller. Par exemple, calibrez l’enveloppe budgétaire maximale disponible pour les augmentations salariales en lien avec la direction financière. Décidez quelles mesures vous êtes prêt à concéder et quels points sont non négociables. Pensez également à des alternatives aux demandes coûteuses : par exemple, si vous ne pouvez pas augmenter beaucoup les salaires, préparez des mesures de compensation (nouveaux avantages salariés, primes d’intéressement, amélioration de la mutuelle...).
Les bonnes pratiques de négociation pour les RH
Durant toute la phase de négociation, certaines bonnes pratiques peuvent faire la différence et aboutir à un meilleur résultat pour tous :
- Voir la NAO comme une concertation, pas une confrontation : Adoptez un état d’esprit ouvert et constructif. Même si des désaccords surgiront, abordez la NAO comme un moment privilégié de dialogue social et non comme un combat. Montrez que vous êtes prêt à écouter les revendications et à chercher des compromis. Si l’employeur se montre inflexible d’emblée, les interlocuteurs syndicaux risquent de l’être tout autant. À l’inverse, une attitude d’écoute et de respect, sans prendre les critiques pour des attaques personnelles, permet souvent de désamorcer les tensions.
- Communiquer avec transparence et s’appuyer sur des faits : Pour instaurer un climat de confiance, rien de tel que la transparence. Partagez honnêtement les contraintes de l’entreprise (budget limité, commandes en baisse…). N’hésitez pas à montrer des données chiffrées pour justifier vos positions. La transparence aide à éliminer la méfiance et à focaliser le débat sur les solutions.
- Faire preuve de créativité dans les concessions : Si les syndicats réclament quelque chose que vous ne pouvez accorder pleinement, proposez des alternatives innovantes. Si une hausse de salaire est impossible, peut-être que d’autres solutions existent pour améliorer la rémunération des salariés. Cette souplesse peut déboucher sur un compromis "gagnant-gagnant".
- Documenter et formaliser les échanges : Au fil des réunions de NAO, veillez à garder une trace écrite des avancées. Faites en sorte qu’un compte-rendu ou un procès-verbal soit rédigé pour chaque réunion. Cela permet de clarifier ce qui a été proposé, ce qui a été accepté ou refusé, et d’éviter les malentendus à la session suivante. En fin de négociation, s’il y a accord, vous aurez déjà une base pour rédiger le texte final.
Comment formaliser un accord NAO
Au terme des négociations, deux cas de figure se présentent : soit un accord est trouvé entre l’employeur et les syndicats, soit les discussions n’aboutissent pas. Dans tous les cas, il faut formaliser par écrit la conclusion de la NAO.
Si un accord est conclu, il s’agit d’un accord collectif d’entreprise à part entière. Il doit être rédigé et signé par les parties avant d’être déposé officiellement. L’employeur a l’obligation de transmettre le texte de l’accord via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, afin qu’il soit enregistré auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, emploi, travail et solidarités). Il doit également envoyer un exemplaire au secrétariat du Conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise. Ce dépôt garantit l’opposabilité juridique de l’accord et sa publicité (un accord d’entreprise devient consultable par tous sur la base nationale des accords, sauf clauses de confidentialité sur certains éléments). L’accord NAO, une fois en vigueur, engage l’employeur à mettre en œuvre les mesures convenues aux dates prévues.
Si aucun accord n’est trouvé, l’employeur doit établir un procès-verbal (PV) de désaccord. Ce document, signé de la partie employeur, mentionne que la négociation s’est terminée sans accord. Il doit obligatoirement contenir les propositions finales de chaque partie sur les différents thèmes, ainsi que les points de désaccord et leurs motifs. Le PV de désaccord doit lui aussi être transmis à la DREETS et au Conseil de prud’hommes. Les syndicats peuvent choisir de ne pas le signer s’ils veulent marquer leur désaccord jusqu’au bout, mais cela n’empêche pas sa validité juridique.
Pensez à communiquer en interne sur le résultat de la NAO une fois qu’il est acté, afin de jouer la carte de la transparence jusqu’au bout.
NAO et stratégie RH : un levier pour le dialogue social
Favoriser la confiance et l’engagement
Au-delà des chiffres et des textes d’accord, la NAO est avant tout un moment de dialogue qui peut avoir un impact fort sur la culture d’entreprise. Bien menée, elle constitue un outil pour renforcer la confiance entre employeur et salariés.
En effet, lorsque la direction se montre à l’écoute des préoccupations exprimées et apporte des réponses, même partielles, les collaborateurs se sentent considérés. Ce climat d’écoute et de reconnaissance favorise leur engagement dans le travail. Inversement, si les salariés ont le sentiment que la NAO est expédiée ou purement formelle, cela peut engendrer de la déception et du désengagement.
Renforcer la marque employeur à travers le dialogue social
Le dialogue social, à travers la NAO, joue un rôle parfois sous-estimé dans l’image de l’employeur. Une NAO bien gérée peut en effet devenir un véritable atout pour la réputation pour l’entreprise.
Une société qui communique de façon transparente sur ses négociations, qui souligne les efforts faits pour les salariés et qui prend en compte leurs besoins, renvoie l’image d’un employeur attentif et socialement responsable. Cela peut être un argument de poids pour fidéliser les talents et attirer de nouveaux candidats. À l’inverse, une NAO perçue comme fermée ou au rabais, peut entacher la marque employeur en donnant l’image d’une direction sourde aux demandes de ses salariés.
Dans un marché du travail tendu, afficher un dialogue social de qualité est un avantage compétitif. Par extension, une entreprise qui respecte ses obligations sociales et va même au-delà en termes de dialogue gagne en crédibilité et en confiance auprès du public et des partenaires.
Autant transformer cette contrainte annuelle en avantage stratégique !
FAQ sur la NAO en entreprise
Qu’est-ce que la NAO ?
La NAO (négociation annuelle obligatoire) désigne la négociation collective périodique que l’employeur doit organiser avec les représentants du personnel dans les entreprises ayant des syndicats. C’est un moment formel de discussion, menant éventuellement à des accords améliorant les conditions de travail et de rémunération des salariés.
Qui est concerné par la NAO ?
Toutes les entreprises où existe au moins un syndicat représentatif sont concernées par l’obligation de NAO. En pratique, cela vise surtout les entreprises de 50 salariés et plus, car ce seuil permet la désignation de délégués syndicaux. Dans les entreprises de moins de 50 salariés sans présence syndicale, il n’y a pas de NAO obligatoire. Lorsque la NAO a lieu, elle implique l’employeur (ou la direction) et les représentants syndicaux des salariés.
Quelle est la signification de NAO ?
NAO est l’abréviation de Négociation Annuelle Obligatoire. En d’autres termes, c’est le nom donné aux négociations collectives qui doivent se tenir de façon régulière (en principe chaque année, sauf accord contraire) sur certains sujets imposés par le Code du travail. Le terme "obligatoire" signifie que l’employeur a l’obligation d’inviter les syndicats à négocier, mais pas forcément d’aboutir à un accord.
Quels sujets aborder en NAO ?
La loi a défini trois grands chapitres de négociation obligatoire. Premièrement, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur. Deuxièmement, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Troisièmement, la gestion des emplois et des parcours professionnels. En pratique, lors d’une NAO, on parle donc de rémunération, d’organisation du travail, des mesures pour améliorer le bien-être des salariés, de l’égalité et de la diversité, et de la façon dont l’entreprise anticipe l’évolution des emplois et compétences.
Quand doivent avoir lieu les NAO ?
Par défaut, la négociation annuelle obligatoire a lieu chaque année. La périodicité annuelle est la règle générale, généralement calée une fois par an à date fixe (souvent en fin d’exercice). Cependant, un accord d’entreprise peut fixer une fréquence différente (tous les 2, 3 ou 4 ans) pour tout ou partie des thèmes, sans dépasser 4 ans d’intervalle. Sans accord dérogatoire, l’employeur doit donc convoquer les syndicats au moins une fois par an pour la NAO.